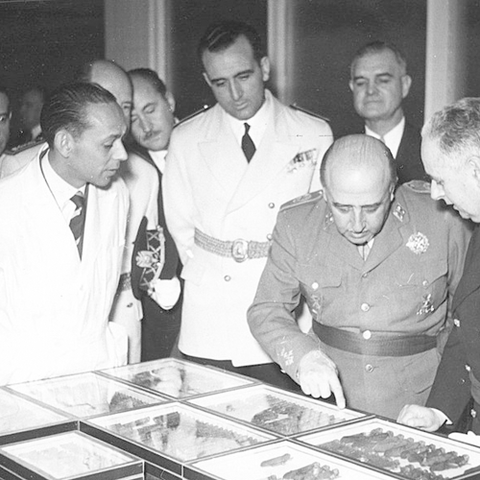Coord.: Christophe Araújo (Université Paris Nanterre), Rubén Cabal Tejada (Universidad Autónoma de Madrid), Misael Arturo López Zapico (Universidad Autónoma de Madrid), Céline Vaz (Université Polytechnique Hauts-de-France)
Org. : Universidad Autónoma de Madrid ; Université Polytechnique Hauts-de-France ; Casa de Velázquez ; Escalas, groupe de recherche en histoire connectée de la contemporanéité
Activité s'inscrivant dans le cadre du projet IberPro : Groupes professionnels et États autoritaires dans la péninsule ibérique au XXe siècle. Perspective comparée (Méditerranée, Amérique latine), soutenu par la Casa de Velázquez entre 2026 et 2028
Lieu :
Universidad Autónoma de Madrid
Présentation
À l’automne 2024, la RTVE a diffusé Las abogadas, librement inspirée du parcours d’avocates spécialisées en droit du travail, engagées dans l’opposition à la dictature franquiste dans les années 1960-1970, et dont le parcours est marqué par l’attentat d’Atocha de 1977, perpétré par des militants d’extrême-droite dans le but de fragiliser le processus de transition démocratique en cours. Cette série télévisée, qui met en lumière des figures féminines de l’opposition au franquisme, rappelle le rôle singulier joué par certains acteurs professionnels – individuels ou collectifs – dans les années de transition de la dictature à la démocratie en Espagne. Au Portugal, les grèves d’enseignants et de médecins au début des années 1970 témoignent du rapprochement de certaines professions intellectuelles avec les formes de lutte et d’organisation du monde ouvrier avant même le « Processus Révolutionnaire en Cours » (Processo Revolucionário Em Curso) ouvert par la révolution des Œillets du 25 avril 1974, incitant à inscrire celui-ci dans une séquence de démocratisation de la société portugaise et de ses institutions de plus longue durée.
Le présent colloque a précisément pour objectif d’explorer et de caractériser les rapports entre les groupes professionnels et le politique dans le contexte de la fin de la dictature de Francisco Franco (1939-1975) en Espagne, et du régime dictatorial portugais (1926-1974), en se focalisant sur le cas des professions libérales ou intellectuelles. Par-là, il s’agit d’envisager le changement politique à un niveau intermédiaire, par les groupes d’intérêt et les mouvements sociaux (Schmitter : 1995). A l’instar des intérêts de classe ou sectoriel, les actions et attitudes de ces groupes professionnels – regroupés ou pas en associations – n’ont peut-être pas déterminé le calendrier du changement de régime ou son issue immédiate mais ils ont participé à discréditer et contester le caractère indispensable du pouvoir autoritaire ou à influer sur la nature de la démocratisation. Les tentatives du pouvoir pour renforcer leur contrôle, comme c’est le cas en Espagne avec la loi du 13 février 1974 sur les collèges professionnels, soulignent le rôle que les groupes professionnels ont pu jouer dans la fin des dictatures.
Compte tenu de leur caractère interventionniste et corporatiste, les dictatures espagnole et portugaise approfondissent le mouvement de renforcement mutuel de l’État et des groupes professionnels et la dynamique d’affirmation des groupes d’intérêt initiées aux XVIIIe-XIXe siècles (Linz : 1988 ; Villacorta Baños : 1989 ; Dubar, Tripier : 1998 ; Offerlé : 1998). En situation autoritaire, les groupes professionnels et leurs instances représentatives sont des espaces privilégiés où se jouent des dynamiques de pouvoir et de contrôle. L’État, comme principale instance de reconnaissance et de légitimation sociale peut s’appuyer sur eux pour renforcer son assise/autorité ou ses capacités d’actions en faisant appel à l’expertise de groupes professionnels déterminés ou, au contraire, les réprimer s’ils sont perçus comme une menace ou un obstacle à ses orientations politiques, économiques ou sociales, ce qui favorise les attitudes de conformité et d’allégeance. De l’autre côté, l’État corporatiste favorise la pénétration des intérêts professionnels au sein de l’appareil du pouvoir.
Les professions libérales ou « établies » (avocats, médecins, architectes, ingénieurs, etc.), caractérisées par le monopole légal sur le droit d’exercer certaines pratiques ou l’usage réservé d’un titre professionnel, et dotées de structures de régulation spécifiques ; mais aussi d’autres professions intellectuelles (enseignants, chercheurs par exemple), sont affectées de façon spécifique par le contexte autoritaire. Ces « professions intellectuelles » – terme générique que nous emploierons pour désigner l'ensemble de ces professions – parviennent globalement à rester en marge de l’organisation corporatiste (représentation propre au sein de la chambre corporative, restauration progressive d’un fonctionnement démocratique des organisations professionnelles), et à conserver ou obtenir d’autres avantages symboliques ou économiques. Pour le pouvoir autoritaire, ces concessions sont un moyen de garantir le soutien de ces élites sociales ou économiques dont les intérêts sont divers. L’hétérogénéité caractérise en effet ces métiers intellectuels compte tenu de la variété des secteurs d’activité ; des conditions d’exercice, qui diffèrent notamment suivant le statut qui leur est associé (indépendant, fonctionnaire, employé) (Sapiro : 2006) ; des modes d’organisation (institutions ordinales, groupements associatifs, syndicat) ; et de leur ancienneté, qui influe à son tour sur leur degré de structuration, leur prestige et leur capacité d’action, individuelle ou collective. Mais, au-delà de cette diversité apparente, ces professions partagent le caractère intellectuel de leur activité et, en général, une rhétorique professionnelle du désintéressement et de la responsabilité, au fondement de leur revendication d’autonomie (Paradeise : 1985). Entre l’État, et le marché, au-delà de leurs intérêts propres, elles seraient au service de la défense du « public », ainsi qu’on l’observe chez les avocats (Karpik : 1995). Cette idéologie professionnelle prend un autre relief et est réinvestie par une partie des membres des professions intellectuelles à partir des années 1960, dans une séquence de contestation croissante des États autoritaires et de constructions d’alternatives sociales et démocratiques.
Le colloque vise donc à cerner les formes et la contribution des « professions intellectuelles » au processus de transition et de démocratisation en Espagne et au Portugal des années 1960-1970. En se focalisant sur ces groupes professionnels, il s’agit d’approfondir les possibilités et les cadres de l’opposition aux dictatures. En raison de leur autonomie et de leur capital social, les professions à statut et les professions intellectuelles ont des capacités de résistance et de protestations plus élevées que d’autres groupes sociaux. L’objectif est aussi d’explorer l’évolution des relations aux pouvoirs autoritaires de groupes appartenant en majorité à la bourgeoisie ou aux classes moyennes, qui ont pu bénéficier de positions privilégiées ou ont soutenu ces régimes, avant de s’en distancier (González : 2015 ; Hoffmann : 2023). Mais il s’agira également de montrer l’hétérogénéité de ces groupes, qui peuvent être traversés par des clivages politiques, sociaux, générationnels ou professionnels, qui induisent des attitudes et des positions des individus à l’égard des régimes autoritaires. Enfin, l'objectif est de mieux comprendre les relations entre le politique et les sphères du savoir et des connaissances spécialisées en contexte autoritaire et dans les phases de changement politique.
Le choix d’une séquence d’une vingtaine d’années renvoie à la volonté de considérer le processus de transition démocratique comme un processus long, incluant non seulement des changements politiques et institutionnels (partis, élections, opinion publique, culture politique) mais aussi sociaux et économiques. Il traduit aussi le souci de ne pas singulariser a priori les relations des groupes professionnels aux États en contexte autoritaire mais davantage de montrer leurs capacités d’adaptation – sinon de réinvention – au changement politique. Si l’Espagne et le Portugal ont en commun des modes d’organisations professionnelles et corporatistes et une même séquence chronologique de fin des dictatures et de transition vers l’établissement de régimes démocratiques, l’objectif du colloque sera de montrer les points communs et les différences dans les temporalités, les possibilités et les modalités d’action des groupes professionnels à la fin des dictatures.
Trois axes de questionnement sont privilégiés. Les propositions pourront s’inscrire dans l’un d’entre eux ou au croisement de plusieurs d’entre eux. Pluridisciplinaire, le colloque est ouvert aux propositions d’historien·nes, mais aussi de sociologues et de politistes et de tous les chercheur·ses intéressés par les dynamiques professionnelles présentées.
Axe 1 : La politisation des professions intellectuelles : facteurs, temporalités, espaces
À partir des années 1960, s’observe une plus forte politisation de la société civile à laquelle les professions libérales et d’autres professions intellectuelles participent plus que d’autres. Les propositions permettant d’envisager, les facteurs de cette politisation – changement générationnel, libéralisation relative, ouverture et échanges internationaux, etc. – ; ses temporalités – sous les régimes autoritaires, au moment du changement de régime ou postérieurement – ; ainsi que ses espaces – Université, mondes du travail, partis politiques d’opposition, organisations professionnelles, sont les bienvenues. L’attention pourra être portée à retracer des trajectoires individuelles ou collectives (milieu social, formation, carrière, réseaux) emblématiques de l’engagement des professions intellectuelles. La manière dont les organisations professionnelles sont affectées par la politisation d’une partie de leurs membres pourra être approfondie. Sont-elles motrices, attentistes ou hostiles à cette évolution ? Ne deviennent-elles pas, surtout, un enjeu de lutte pour les opposant·es comme pour les soutiens du régime ? Sont ici posées les divergences fortes qui peuvent exister entre les membres d’un même groupe professionnel en termes d’âge, de position professionnelle, de conviction politique, qui peuvent jouer sur son influence et ses capacités d’action, et que le colloque invite à prendre en compte.
Axe 2 : Changements professionnels et changements politiques
Il s’agit d’approfondir les relations plurielles entre dynamiques professionnelles et changements de l’appareil d’État au cours des années 1960 et 1970. Pour faire face au défi de la modernisation et de l’ouverture de l’économie, les régimes autoritaires de la péninsule ont pu être amenés à mobiliser des spécialistes et des experts, en dépit de leur politisation réelle ou supposée. Des professionnels ont pu ainsi à la fois servir le régime, s’y opposer ou tenter de le faire évoluer, puis contribuer à élaborer les nouvelles institutions. Les propositions sont aussi invitées à interroger les ressorts professionnels de l’engagement des professions intellectuelles contre ou en faveur du régime. Les cohortes nombreuses de jeunes architectes sont ainsi d’autant plus enclines à se mobiliser contre le régime au nom de la « fonction sociale » de l’architecture, que leur entrée sur le marché du travail est difficile (Vaz : 2017). Le colloque vise aussi à interroger les profits tirés par les groupes professionnels, ou certains de leurs membres, de leur engagement contre les régimes autoritaires dans la phase de transition. La légitimité tirée du rôle d’« opposant » permet-elle de jouer un rôle politique dans le processus institutionnel de démocratisation (rôle dans les gouvernements provisoires, candidature aux élections, définition des institutions) ou d’obtenir des gains corporatistes ? Inversement, y a-t-il des coûts politiques et professionnels pour les soutiens des régimes déchus ?
Axe 3 : Professions intellectuelles et engagements politiques et sociaux
Le dernier axe invite à développer les formes concrètes et les moyens de l’engagement des professions intellectuelles dans les dernières années des dictatures et durant le processus de transition politique et institutionnel. L’objectif est notamment d’éclairer comment ces groupes professionnels ont pu être déterminants pour soutenir et appuyer la mobilisation de groupes sociaux ciblés par le régime ou mobilisés contre celui-ci ; de voir comment les associations professionnelles ont pu être des ressources – ou pas – dans ces luttes sociales ou politiques ; d’envisager aussi les liens qui ont pu s’établir entre différentes professions au service de ces luttes. D’autres questions peuvent être approfondies dans le cadre des propositions. Quelles rhétoriques, quels discours viennent justifier ces prises de position ou ces interventions ? Quel type de liens s’établissent entre les membres des professions intellectuelles et les autres acteurs des mobilisations sociales (collaboration, coopération, subordination, domination) ? Quand et comment les liens se sont-ils distendus entre ces différents acteurs de la société civile ? Quel rôle ont joué les partis politiques ?
Comité scientifique
- Irene Díaz Martínez
Universidad de Oviedo
- Xavier Domènech Sampere
Universidad Autónoma de Barcelona
- Ángeles González Fernández
Universidad de Sevilla
- Concepción Langa Nuño
Universidad de Sevilla
- Darina Martykánová
Universidad Autónoma de Madrid
- Carme Molinero Ruiz
Universidad Autónoma de Barcelona
- Juan Luis Pan-Montojo González
Universidad Autónoma de Madrid
- Javier Tébar Hurtado
Universidad Autónoma de Barcelona
- Carlos Sanz Díaz
Universidad Complutense de Madrid
- Nicolas Sesma Landrin
Université de Grenoble
- Luísa Sousa
Universidade Nova de Lisboa